
Modélisation des phènomènes optiques
>>
Réflection
>> Réfraction
>> Rayon d'ombre
>> illumination
>> Eclairage
Le lancer de rayons utilise les propriétés physiques et mathématiques réelles de la lumière, ce qui permet d'obtenir des résultats photo-réalistes. Les phénomènes optiques qui sont rendus par le moteur de lancer de rayons sont la réflexion, la réfraction et les ombres.
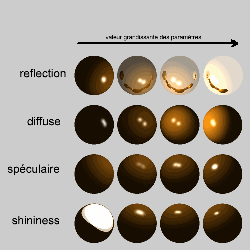

Si la surface d'un objet est réfléchissante,
l'algorithme de lancer de rayons doit non seulement calculer la valeur
de l'illumination sur la surface, mais aussi ajouter les reflets des autres
objets de la scène. Pour ce faire, il suffit uniquement de connaître
l'angle auquel part le rayon réfléchi, puis de lancer un
nouveau rayon dans cette direction pour déterminer ce qui se reflète.
Le calcul de l'angle de réflexion est immédiat dès
que l'on connaît la valeur de la normale à la surface. On
a le vecteur directeur du rayon réfléchi par la formule
![]()


La réfraction permet de prendre en compte
la transparence des objets de la scène. Un rayon qui vient frapper
un objet transparent va être dévié en fonction de
l'indice de réfraction du matériau de cet objet, mais aussi
de celui de celui du matériau d'où arrive le rayon (la plupart
du temps l'air, dont l'indice de réfraction est proche de 1). On
détermine l'angle de déviation du rayon transmis lors d'un
changement de matériau par la formule
![]()
La valeur du vecteur directeur du rayon transmis est obtenue avec la formule
![]()

Rayon d'ombre
Pour déterminer si le point d'intersection entre la surface et
le rayon contribue directement à la valeur du pixel considéré,
on envoie un rayon en direction de chaque source lumineuse, ce qui permet
de déterminer si un objet opaque de la scène n'occulte pas
cette source.
La contribution des
sources de lumière
Si un point n'est pas occulté d'une source
de lumière par un objet opaque, cette source de lumière
aura une contribution sur la couleur perçue de l'objet. L'illumination
finale du point sera la somme d'une composante diffuse et d'une composante
spéculaire, et de la contribution de la lumière ambiante.
La composante diffuse
d'une illumination représente le fait que l'énergie d'un
faisceau lumineux s'étale d'autant plus sur la surface d'un objet
si son angle d'incidence est proche de la tangente à l'objet. Pour
un objet de couleur S ayant la propriété d'émettre
le taux rd de lumière diffuse, éclairé par une source
lumineuse de couleur C, on obtient la contribution diffuse suivante :
![]()
avec L le vecteur de lumière incidente, calculé par normalisation du vecteur allant de la position de la lumière vers le point d'intersection.
La composante spéculaire
de l'illumination représente le fait que pour une surface réfléchissante,
plus l'œil (la caméra) se trouve en face des rayons réfléchis,
plus il recevra de lumière. Pour un objet ayant la propriété
d'émettre le taux rs de lumière spéculaire, éclairé
par une source lumineuse de couleur C, on obtient la contribution diffuse
suivante :
![]()
La normalisation de la lumière : On a vu que la l'intensité
en un point est la somme de 3 contributions : diffuse, spéculaire
et ambiante. Il peut donc arriver qu'une ou plusieurs des composantes
de cette intensité dépasse la valeur maximale qu'elle peut
prendre (la valeur de l'intensité d'une composante varie entre
0 et 1 : 0 pour éteinte et 1 pour pleine puissance). Il convient
donc de normaliser ces valeurs pour qu'elles soient cohérentes.
Nous avons choisi de faire du clamping,
à savoir que si une composante dépasse la valeur maximale,
on la remplace par la valeur maximale. Une autre solution serait de déterminer
la composante dont l'intensité est maximale, puis de diviser les
valeurs de toutes les composantes par cette valeur maximale ; ceci créerait
des images plus sombres mais représentant mieux les dégradés
dans les zones intenses de la scène.
Les sources de lumière
Une scène comporte des objets divers,
mais aussi des sources lumineuses qui peuvent être de 3 types différents.
On distingue la lumière ambiante, la lumière ponctuelle,
et la lumière directionnelle.
- La lumière
ambiante : c'est la lumière qui est reçue
de façon uniforme par tout point de la scène, indifféremment
de la position des autres sources lumineuses et des objets de la scène.
Cette lumière ambiante permet d'évider que les zones non
éclairées soient complètement noires, ce qui donne
un résultat plus réaliste étant donné que
tout objet reçoit en réalité une lumière minimale
par réflexion d'autres objets.
- La lumière ponctuelle
: c'est une source lumineuse placée en un point de l'espace, et
qui éclaire uniformément dans toutes les directions. Une
lumière ponctuelle a une influence diffuse et spéculaire
sur la couleur de l'objet.

- La lumière directionnelle
: c'est une source de lumière ponctuelle, mais qui n'émet
que dans une direction.
